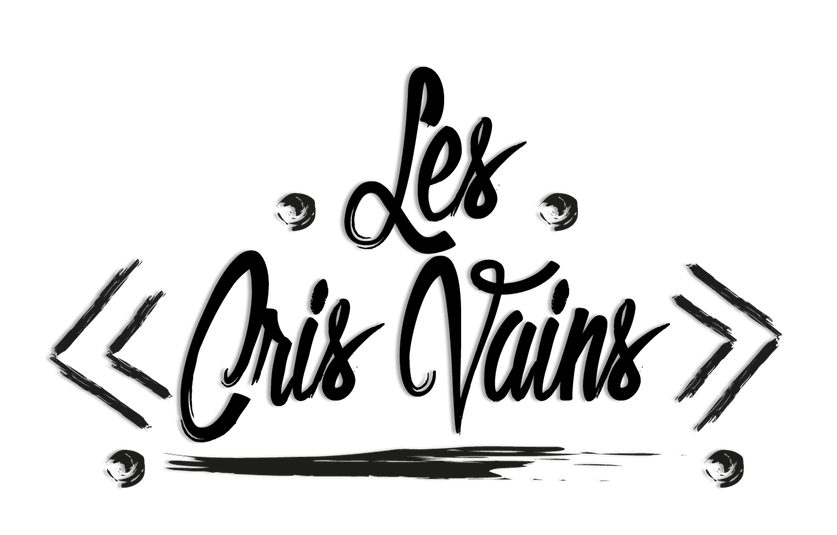–
Essaïda, jour 3
–
Un grondement sourd nous réveille. Qu’est-ce ? Il semble venir du désert. Il est grave, continu, et assez monocorde. Je me précipite, muni d’une arme, à l’entrée du baraquement, rapidement rejoint par François et Daniel. Assiste-t-on à l’arrivée de dizaines de voitures ? Le bruit l’évoque. Est-ce le FLN ?
Et pourtant, devant nous, rien. Le désert reste désespérément vide. Nous entendons nettement ce bruit, nous savons de quelle direction il vient, mais nous ne voyons rien. Quelle frustration, et quelle angoisse. Le caporal nous rejoint. Lui aussi est interloqué, je remarque son regard inquiet. Comme nous, il ne trouve pas de réponse. Paul, le pied-noir, s’avance, le sourire aux lèvres.
« N’avez-vous donc rien remarqué ?
– Quoi donc ?
– Le vent. Il s’est levé. »
Alors que les premiers jours au sud des Aurès s’étaient surtout caractérisé par un temps chaud et un soleil de plomb particulièrement inhospitaliers, je sens effectivement ce matin une légère brise, à peine perceptible.
« Mais ce bruit, d’où vient-il ?
– Cela s’appelle le chant des dunes. C’est un phénomène assez rare, qui se produit quand le sable en surface est agité par le vent. Des milliers de grains de sables rentrent en collision les uns avec les autres, et créent ce son si caractéristique. Rassurez-vous, vous n’êtes pas les premiers à trouver cela étrange ; les berbères pensent qu’il s’agit d’esprits, qui rôdent dans le désert. »
Passé cette première inquiétude, la matinée se déroule sans accroc. Certains vont patrouiller dans le village, tandis que je m’attelle à réparer une radio défectueuse, malheureusement sans succès. A midi, le vent s’est levé. Il n’apporte plus cette touche rafraichissante, mais est désormais chaud et sec. Par bourrasques, il s’engouffre entre les maisons et vient fouetter les visages. Une heure passée, et nous voyons un nuage gigantesque se profiler à l’horizon. A mon grand étonnement, il est jaunâtre, et semble frôler les dunes. Paul comprend immédiatement de quoi il en retourne.
« C’est une tempête de sable, on doit se mettre à l’abri. »
Nous rentrons donc dans le baraquement, fuyant le nuage qui progresse rapidement. Encore dix minutes, et il est à notre niveau. C’est impressionnant. En pleine après-midi, le ciel s’assombrit, et un voile jaune, digne d’un brouillard intense, nous masque la vue à dix mètres. Je distingue le dattier qui, pourtant solidement enraciné, est chahuté par les éléments. Une de ses branches se brise. Le vent produit désormais un hurlement constant et aigu, et des tourbillons renversent tout sur leur passage. La vieille porte en bois vermoulu du baraquement résiste difficilement, elle grince de toute part.
La lumière vacille, avant de s’éteindre. Les câbles d’alimentation ont dû être coupés par la force du vent. Cela nous pousse à utiliser une vieille lampe-tempête à pétrole. Nous jouons quelques heures aux cartes sous sa lumière diffuse, pour passer le temps. Rien d’autre à faire.
Allant préparer à manger pour le groupe, je m’arrête devant la fenêtre de la cuisine, qui donne sur la route. Il n’y a toujours aucune luminosité, et l’intensité n’est pas redescendue.
Soudain… Quoi ? Une lueur ? Qu’est-ce ? Qu’était-ce ? Elle a déjà disparu. J’ai cru distinguer sur la route une petite lumière. Était-ce quelqu’un, qui profitant de la tempête, fuyait le village ? J’ai très bien pu me tromper. Et si ce n’était qu’un éclaircissement fugace dans le ciel, laissant passer quelques rayons de soleil ? Je n’en sais rien. Je retourne sur mes pas avertir le caporal.
« On peut pas se permettre de laisser faire un terroriste, me répond-il, mais ce serait de la folie pour nous de sortir par ce temps-là. Si c’est bien un fugitif, il doit avoir une connaissance du désert qu’on a pas, ce serait vain et dangereux de le poursuivre. Mais demain, je veux qu’on interroge tous les crouilles. On leur tirera les vers du nez, coûte que coûte. »
La journée s’achève sans que la tempête soit passée. Nous nous couchons avec la désagréable sensation d’être isolés, dans un environnement qui devient de plus en plus menaçant.
–
–
–
25 janvier 2019
–
Après avoir refermé la porte du hall de mon immeuble parisien, je récupère mon courrier. Coincée dans un monticule de publicité, une lettre à mon nom. Fait étonnant, le nom de l’expéditeur est marqué à la plume : « François de Murat » – Pierre a donc réussi à le contacter. Avant même de me plonger dans sa lecture, j’envoie un SMS à mon éditeur, afin de savoir s’il a réussi à contacter tous mes anciens compagnons. Sa réponse intervient alors que l’ascenseur arrive à mon étage. « J’ai contacté François, Paul, et avec plus de difficultés Jean-Pierre. Aucune réponse définitive de leur part. Les autres sont décédés. Naturellement, aucun contact avec ʺXʺ ».
Rentré dans mon appartement, je m’installe dans le sofa, la lettre sur mes genoux. C’est la première fois depuis soixante ans que j’ai des nouvelles directes d’un membre de l’unité.
« Cher Christian,
Nous n’avons pas reparlé depuis des années, mais j’ai suivi ton ascension politique avec beaucoup d’attention, malgré nos divergences de fond. Cependant, tu le sais bien, ce n’est pas pour parler de ça que je prends contact avec toi aujourd’hui.
Il y a quelques jours, ton éditeur m’a appelé, et m’a annoncé ton intention de faire le récit de notre expérience commune en Algérie. Cela a été un choc pour moi. Nous avions fait le serment de ne jamais en parler, et j’avais, bien que difficilement, réussi à enterrer ce traumatisme. Ça n’a pas été simple tous les jours, je ne le prétends pas, et aussi comprends-je sur le fond ton envie de te confier. Mais tu oublies un peu vite que cela ne concerne pas que toi, mais toute une unité – des morts, mais surtout des vivants. »
J’interromps ma lecture. C’était inévitable, je m’en veux de ne pas l’avoir véritablement envisagé auparavant. Bien sûr qu’il ne voudra pas salir sa réputation et abîmer sa retraite bien paisible. Me voilà dans une impasse. Je reprends.
« Effectivement, nous ne risquons plus rien juridiquement. Mais j’ai une famille, des amis, et qu’adviendra-t-il si tous sont au courant des actes auxquels j’ai participé ? Mon entourage se déchirera et me tournera le dos, et je finirai ma vie seul. De ce point de vue-là, j’avoue ne pas comprendre ta démarche. Avec la notoriété qui est la tienne, ne te doutes-tu pas que tout le monde te tombera dessus, ta vie deviendra un enfer, tu seras honni de tous ?
Bref, je trouve ta démarche irresponsable, pour toi comme pour les autres, et en l’état, je m’oppose à la publication de ton livre. Si tu souhaites en discuter avec moi, je suis prêt à me déplacer sur Paris pour te rencontrer.
Cordialement. »
Je relis la lettre une deuxième fois, un goût amer dans la bouche. Je suis bloqué. Tellement de questions se posent désormais : a-t-il raison de m’enjoindre à ne pas publier ? Dois-je anonymiser les protagonistes ? Les noms seraient facilement retrouvables, par n’importe quel enquêteur un peu pointilleux, et notamment par Saski.
Alors il me faut absolument le convaincre. Mais comment ? Je ne vois pas.
Etrange coïncidence, je reçois dans la même journée des mails des deux autres soldats encore en vie, Paul et Jean-Pierre. En substance, leurs messages sont les mêmes que François : ils s’y opposent, cela implique trop de sacrifices pour eux. N’ayant pas la possibilité légale de publier sans leur accord, je suis paralysé.
–
–
–
Essaïda, jour 4
–
La matinée est tendue. Le possible passage d’un fellagha pendant la tempête inquiète le caporal, qui pensait le village pacifié. X (comme je regrette de l’avoir oublié ! Protagoniste essentiel) propose sérieusement d’aller voir les habitants et de les violenter un peu, pour – je cite – qu’ils « crachent le morceau ». Sa proposition provoque l’hilarité de François, Daniel et Jean-Pierre. Paul a un sourire gêné. Je lance un regard inquiet à Claude et Martin. Mon unité me fait peur.
L’électricité n’étant pas rétablie, le caporal envoie dans un premier temps Daniel et Martin dans la Jeep suivre les câbles le long de la route, pour voir s’ils ont été sectionnés. Le reste de l’unité est envoyé dans le village, à la recherche de possibles traces d’un passage. J’en suis. Cela se résume à encore une fois aller fouiller les maisons, interroger les gens quand ils nous comprennent, avec le vain espoir que l’on trouvera quelque chose de nouveau. Bien entendu, nous ne trouvons rien. Les habitants sont encore plus méfiants qu’avant-hier, et comment leur reprocher ? Nous sommes une vraie force d’occupation, avec toute la rudesse qu’elle implique. Les Algériens se soumettent avec mauvaise grâce aux contrôles, et la situation dégénère parfois. Je me souviens voir de dos X mettre en joue le fils du chef du village, qui refusait d’être contrôlé. Même François, qui n’hésite pourtant pas à être brutal, le retient du bras et l’enjoint à se calmer.
En soirée, Daniel et Martin reviennent : un éboulement à quelques kilomètres du village a coupé la route et sectionné les câbles de communication. Nous ne pouvons rien faire, si ce n’est attendre quelques jours l’arrivée d’engins destinés à déblayer. En attendant, nous sommes coincés, sans électricité ni moyens de communication. Le caporal nous annonce que nous nous relayerons désormais pour veiller autour du baraquement. Notre isolement nous met dans une position délicate, et si le FLN est dans le coin, nous devons rester alertes. On m’impose donc la première nuit de garde, en binôme avec Claude. Je suis déjà exténué, la nuit va être très longue.
Claude est quelqu’un d’assez étrange. Il me parle avec difficulté, par saccades extrêmement rapides, comme s’il craignait d’oublier ses mots. Son regard est fuyant, nerveux, comme je l’avais remarqué à notre arrivée. Nous discutons un long moment, nos dos posés sur le tronc du vieux dattier, bien amoché par la tempête de la veille. Il n’ose pas se confier, alors je commence à lui parler de moi. Je lui raconte mes études à Paris. Je lui parle de mes convictions de gauche, de mon pacifisme. La discussion finit enfin par s’engager. Il me révèle être communiste ; lui-même partisan de l’indépendance de l’Algérie et fermement antimilitariste, il n’a pas non plus eu le choix de s’engager. Depuis la disparition de Maurice Audin il y a trois ans, les communistes présents de gré ou par les circonstances en Algérie se sentent sous la menace de l’armée, et lui-même a peur de notre hiérarchie depuis le début de la mission. Son étrange silence qu’il observait ces quelques jours n’est que le reflet de son mal-être, et de sa volonté de ne pas parler de ses convictions. Un personnage fragile mais attachant au fond, qui explique à lui tout seul le malaise des appelés du contingent.
Nous fumons des cigarettes pour faire passer le temps. L’obscurité envahit progressivement la cour à côté du baraquement ; je me décide à aller chercher la lampe à pétrole dans la cuisine, à quelques pas. Je marche quelques mètres, essayant de me repérer à tâtons. Arrivé dans la cuisine, je distingue la forme de la lampe, je m’en saisis avec un paquet d’allumettes et retourne sur mes pas. A peine ai-je le temps de faire quelques mètres que retentit un bruit clair de verre brisé, suivi d’une intense douleur dans ma jambe droite. Je tombe lourdement au sol. Plus de bruit. Juste le silence.
Me dépêchant d’allumer la lampe, je parviens à localiser l’origine de la douleur, qui reste malgré tout supportable. La fenêtre de la cuisine a été brisée, et un large éclat de verre s’est fiché dans mon mollet, qui saigne abondamment. Claude, inquiet de ne pas me voir revenir, vient à ma rencontre. Il n’a rien entendu, ni vu personne. Me voyant blessé, il s’occupe de me prodiguer les premiers soins. Un bon garrot pour éviter l’hémorragie, puis il retire le morceau de verre avec délicatesse. Une désinfection à l’alcool, qui laisse échapper une vilaine grimace de mon visage, puis un large bandage autour de mon mollet. Après quelques minutes, le saignement se fait moins prononcé, la douleur baisse en intensité – le plus dur est passé.
Claude est parti en informer le caporal, et ils reviennent tous deux vers moi. Dessagny est franchement énervé. Son regard noir se porte sur moi, comme si j’étais en quoique ce soit coupable de ma situation.
« Ils vont le payer. Je vous le dis, les ratons vont arrêter de se foutre de notre gueule. Demain on les cuisine, ces enfoirés de terroristes vont pas nous échapper. »
Ma veille du baraquement s’achève donc avec quelques heures d’avance. Je pars me reposer tandis que le caporal prend ma place auprès de Claude.
–
–
–
27 janvier 2019
–
Aujourd’hui est un jour de commémoration. Il y a soixante-quatorze ans était libéré le camp d’Auschwitz, et cette journée est désormais dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste. En tant que responsable politique de premier plan, et bien que je sois retiré de la vie publique, je me dois d’être présent au mémorial de la Shoah, au cœur de Paris, aux côtés du gouvernement actuel et d’autres officiels. Le Président souhaitait me voir à ses côtés. Dans ce froid matinal, l’ambiance est empreinte de gravité, les gestes de chacun sont lents et solennels. Le grand rabbin de Paris prononce un discours pétri d’émotion, condamnant avec force ce projet fou d’extermination.
Je ne peux m’empêcher de penser à Essaïda. Bien entendu, ce n’est pas génocide, mais cela reste un acte de guerre terrible auquel j’ai participé. Mon esprit quitte un instant la cérémonie. Je ferme les yeux et vois ces scènes insoutenables. Je vois des visages inertes, et des hommes défigurés par la douleur. Le fils du chef se présente à moi. Je n’ai jamais su son nom. Il m’observe d’un regard transperçant, me faisant sentir le poids de mes erreurs. Il semble me dire « pourquoi ? ».
****
« Christian, ça va ? »
C’est le Président, penché au-dessus de moi, qui m’adresse la parole. Je reprends mes esprits, et tente maladroitement de le rassurer.
« Est-ce que tu souhaites qu’on appelle un médecin ? Tu n’as pas l’air en grande forme. »
Effectivement, mes joues humides m’apprennent que j’ai pleuré, et mon corps est encore tremblant. Je me redresse sur ma chaise et lui assure que tout va bien, malgré ma respiration haletante. La cérémonie se poursuit quelques minutes, et je tente tant bien que mal de faire bonne figure, offrant des sourires de façades à des connaissances. A la sortie du site, la presse attend les officiels. Si des questions assez classiques, sur l’importance du devoir de mémoire ou la résurgence de l’antisémitisme, sont posées au Président, un journaliste fini par m’interpeller.
« Monsieur Launay, qu’avez-vous à dire sur votre rôle en tant que soldat pendant la guerre d’Algérie ? »
Mon sang se glace. Initialement caché derrière la cohue de journaliste, son visage se dévoile sur ma droite. Carl Saski, de Medianet. Chauve, une épaisse paire de lunettes, de carrure moyenne, l’homme a un regard glacial. Bafouillant quelques mots, je finis par dire dans une langue de bois que j’ai appris avec le temps à maîtriser à la perfection que « je suis ici pour commémorer une des époques les plus tragiques de notre histoire, et je ne répondrais qu’à des questions sur le sujet. Ce ne sont d’ailleurs ni le lieu, ni l’événement adéquats ».
La question de Saski a interpellé ses confrères, qui ne comprennent pas ce qu’il se joue. Ils discutent entre eux, à voix basse, se posent des questions, et regardent Saski, comme dans l’attente d’une réplique. Lui-même m’observe, avec un léger sourire aux coins des lèvres. Il est fier de son coup, et ne semble pas vouloir enchaîner sur d’autres questions. Pourquoi a-t-il fait cela ? Pour me prévenir, que désormais, il sait ? Mais que sait-il ? Tout ? Des données parcellaires ? A-t-il uniquement vu mon nom dans des dossiers déclassifiés ? Je n’en sais rien.
Un journaliste me reprend finalement : « Savez-vous ce que notre confrère sous-entend ? Que s’est-il passé vous concernant durant la guerre ? »
Je me défends comme je peux : « Je ne répondrai à aucune question sur le sujet » – quand on est en difficulté, toujours privilégier le silence.
Harcelé par la presse, qui s’est même désintéressée du Président pour me suivre telle une nuée d’insectes, je me trouve contraint à partir. Je hèle un taxi, qui m’emmène à mon domicile. En route, je me décide à contacter Saski. Sachant par avance que je ne pourrais le faire taire, je dois le contraindre à ne publier son enquête qu’après mes mémoires, et la tâche ne s’annonce pas simple. Quel intérêt aurait-il à se laisser voler un scoop ? J’appelle Pierre, pour qu’il trouve le téléphone du journaliste – il a de nombreux contacts.
Dans l’immédiat, ce problème me retire étonnement une épine du pied : il me fallait un moyen de convaincre mes anciens compagnons d’armes de l’opportunité de publier ce livre. Je l’ai désormais : si ne je le publie pas, Saski se chargera de raconter l’épisode sans aucun scrupule. Préfèrent-t-ils qu’un journaliste réputé pour coincer politiques et personnalités s’en charge, ou qu’un ancien camarade le fasse ? La chose me semble entendue, leurs réticences devraient disparaître.
Je leur envoie un mail, leur expliquant l’urgence de la situation, et je leur propose une réunion dans quelques temps chez mon éditeur, afin de discuter de cette histoire et régler quelques soucis administratifs.
****
Pierre me communique le numéro de Saski. Je l’appelle, un peu angoissé. Trois longues tonalités, puis l’homme décroche.
« Allo ?
– Bonjour, M. Saski. Christian Launay à l’appareil.
– Oh, ravi de vous entendre, Monsieur Launay. Êtes-vous disposé à me parler ? J’ai des éléments en ma possession qui pourraient vous concerner.
– Je sais très bien ce que vous avez sur moi. Et je sais bien que vous publierez ce que vous avez, coûte que coûte.
– Votre lucidité n’est donc pas qu’une légende. »
L’imbécile se permet d’ironiser. J’enrage déjà, mais je me dois de garder une contenance – je ne suis pas en position favorable, lui comme moi le savons.
« Il se trouve que je ne m’oppose pas à cette publication ; le silence a trop duré, et je veux me libérer de ce poids.
– Voilà qui est sage de votre part, d’autant plus que vous savez bien que vous ne risquez aucune poursuite. Quelle est donc la raison de cet appel ? Au-delà du plaisir d’entendre ma voix, je me doute que vous avez quelques motivations.
– Il se trouve que j’ai pris l’initiative de publier mes mémoires, et je compte révéler au grand public cette histoire, peu m’importent les conséquences. Mais je tiens à être celui qui en parlera en premier. La publication est envisagée pour le 10 mars.
– Je crois comprendre ce que vous me demandez. Vous souhaitez que je ne publie mon enquête qu’après vos aveux, c’est cela ? Cette charmante unité de huit personnes ne… »
Je l’interromps.
« Neuf. Nous étions neuf. Cela à part, vous avez bien compris le sens de ma démarche. Qu’en dites-vous ?
– Neuf, dites-vous ? Intéressant… Et bien j’en dis que je n’aurais absolument aucun intérêt à vous écouter. Soyons raisonnables : l’industrie de la presse, et plus précisément Medianet, fonctionnent uniquement à coups de buzz. Or, vous comprenez bien qu’une enquête journalistique, aussi pertinente soit-elle, ne peut faire le poids face au récit direct du principal protagoniste. A n’en pas douter, vos ventes vont exploser, et mon travail, à qui je consacre toute mon énergie depuis un an déjà, sera au mieux éclipsé, au pire décrédibilisé car absolument pas inédit. »
Il ne lâchera pas l’affaire, je le vois bien, à moins d’obtenir quelque chose de valorisable pour lui. Je tente un va-tout.
« Ecoutez, je crois qu’on peut trouver un terrain d’entente. Le 9 mars, la veille de la publication, je participe à une émission sur le service public, et je compte y faire mes aveux. L’affaire est pour l’instant confidentielle, seule la directrice de la chaîne et une journaliste sont au courant. Que diriez-vous d’y intervenir ? Vous aurez le loisir de me cuisiner comme vous le souhaitez, en direct.
– Une émission, dites-vous ? Cela peut être intéressant.
– Alors, vous acceptez ?
– Disons que oui, mais à une condition. Je veux que vous m’envoyiez dès maintenant vos mémoires. Je mènerai une enquête dessus.
– Si vous le souhaitez. »
Nous nous quittons ainsi. L’issue me soulage, notre compromis me paraît honnête, et surtout inespéré. Dans la soirée, je reçois les réponses de François, Paul et Jean-Pierre. Ils sont a priori d’accord pour que le livre soit publié, c’est la meilleure option. Ils souhaitent cependant que nous nous voyons avant. Ce sera chose faite, dans quelques semaines. Quel soulagement.
–
L’aveu, partie 2 sur 4
Une nouvelle de Maxime Sicard
–